|
|
|
|
|
| Sylviane
Chatelain / Le Livre d'Aimée |
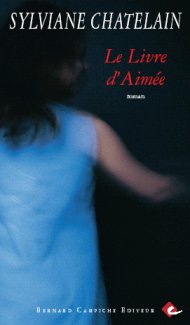
ISBN 2-88241-118-9
|
|
Dans Le
Livre d’Aimée,
tout est suggéré, comme rêvé,
reflété dans un miroir. Comme l’image
lumineuse de cette petite fille à la robe bleue,
témoin des «jours tranquilles de l’enfance».
L’auteur raconte ici une histoire simple - la souffrance,
la révolte de ceux qui sont privés de
l’accès aux livres -, s’interrogeant
sur «les profondeurs instables de la mémoire»
et sur son rôle d’écrivain, en phrases
brèves ouvrant des espaces qui s’imposent
avec une beauté poétique et une évidence
incroyables.
Sylviane Chatelain s’affirme
comme l’une des voix les plus originales de la
littérature suisse française.
Notice biographique
Sylviane
Chatelain est née à Saint-Imier.
Son premier roman, La Part
d’ombre (1988), s’est vu décerner
le Prix Hermann-Ganz 1989 de la Société
suisse des écrivains et le Prix 1989 de la Commission
de littérature française du Canton de
Berne. Son deuxième recueil de nouvelles, De
l’autre côté (1990), a obtenu
le Prix Schiller 1991. Le dernier ouvrage paru de Sylviane
Chatelain, L’Etrangère
(nouvelles, 1999), a encore élargi son audience.
Sylviane Chatelain, Le Livre d'Aimée,
Editions Bernard Campiche, 2002.
Couverture : photographie de Myriam Ramel
|
|
| Extrait
«J’ai posé
ma tête entre mes bras repliés sur la table.
Les mots se cachent. C’est un jeu, ils se cachent
et je les cherche. Un jour ils se lasseront et moi aussi.
Je le crains, parfois je l’espère. Mais
il est encore trop tôt. Je les cherche et je les
attends. Un mot, un seul quelquefois et d’autres
le rejoignent. J’attends qu’ils m’emportent,
me déposent sur le visage, les lèvres
d’inconnus qui meurent si je ne les rejoins pas
ou qui me suivent et me poursuivent, ne s’en vont
pas avant que je n’aie dit et compris ce qu’ils
avaient à me dire.
Rien n’a changé.
Si pourtant: la montagne, son corps de baleine échoué
devant moi a le dos blanc. C’est tôt pour
la première neige.
Ils me font signe, je m’approche,
au dernier moment ils se dérobent. Ils veulent
m’entraîner quelque part, mais je résiste,
je ne veux pas de n’importe quelle route, j’ai
le droit de choisir, de refuser celles qui sont trop
dangereuses, qui sont au-dessus de mes forces. Alors
ils me tournent le dos avec un haussement d’épaules.
C’est un jeu difficile, un peu cruel. Je sais qu’ils
reviendront. Ils reviennent toujours. Ils savent que
je ne peux pas me passer d’eux, que je finirai
par les suivre. Ils sont patients. J’entends leurs
froissements d’ailes, leurs rires qui ressemblent
aux cris confus des oiseaux à l’aube. Ils
décrivent leurs tours loin au-dessus de moi,
ils ne me perdent pas de vue. Je vais céder,
reprendre ma plume. Mais je ne vois pour l’instant
que ce visage, le visage d’une femme, derrière
la vitre embuée d’un car, qui regarde défiler
le paysage, occupée par je ne sais quelles pensées
.»
Extrait de : Le livre d'Aimée
La Presse
Quand le bonheur de lire vous
emporte
Des pages qui s’avancent
dans la respiration d’une fugue: c’est Le
Livre d’Aimée, de Sylviane Chatelain.
Mais puisqu’il s’agit
dans ces pages d’une petite merveille, d’une
grâce d’écriture qui dans sa patience
allusive veille au plus proche de la vie: bien sûr
que vous allez rejoindre ce livre, et jusqu’aux
neiges où il se referme. Dans cette coda de l’hiver
où l’énigme du livre, comme de l’existence,
reste suspendue. Dans la belle lenteur de son musical
cheminement et dans les échos perpétués
de ses accords, Le Livre d’Aimée (que Sylviane
Chatelain signe notamment après Le Manuscrit
et les nouvelles rassemblées dans L’Etrangère)
suit la trace d’un autre livre, dans la mise en
abyme de cet autre Livre d’Aimée, et d’Aimée
justement, dans les temps mêlés où
s’accompagnent et se rejoignent la narratrice et
le personnage. Et dans ce livre du livre, la lecture
est une figure récurrente qui résonne
et revient. Il lit et elle «l’écoutait,
attentive, sous ses paupières baissées,
au cours des mots, à ses lenteurs, ses brusques
écarts, ses lueurs, à ce désir
venu d’amont qu’il charrie, qui nous traverse
et nous emporte vers d’autres mots comme vers le
large.»
Jean-Dominique Humbert
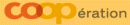

Au moment où le cri et
la violence font souvent office de style littéraire,
on ne peut que se réjouir à la lecture
de Sylviane Chatelain. Ses livres brillent par leur
retenue, par leur atmosphère délicate.
Après L’Etrangère, recueil de nouvelles
paru en 1999, l’auteure jurassienne poursuit avec
Le Livre d’Aimée, une œuvre singulière
et envoûtante.
A coups de phrases brèves,
Sylviane Chatelain évoque, plus qu’elle
ne dit, la souffrance de ceux qui sont privés
de livres. Interrogeant aussi les liens entre fiction
et réalité, elle aborde à touches
discrètes des questions sur le rôle de
l’écrivain, sur le bonheur et les difficultés
d’écrire. Mais Le Livre d’Aimée
est bien loin de toute réflexion intellectuelle.
L’essentiel demeure ce climat que Sylviane Chatelain
sait instaurer par l’intensité de ses «paysages
de mots» et par des images d’une évidence
et d’une puissance extraordinaires, comme celle
de l’école abandonnée ou de cette
mystérieuse fille en robe bleue.
Eric Bulliard
La
Gruyère

L’amateur qui ouvrira Le
Livre d’Aimée de Sylviane Chatelain éprouvera
de la peine à le refermer avant de l’avoir
dévoré jusqu’au bout. Ses phrases
denses, se chapitres brefs, son originale façon
de passer rapidement d’un thème à
l’autre après avoir dit l’essentiel
le captiveront. Un vif désir le poussera, non
pas de découvrir les rebondissements d’une
intrigue mais d’assister au lent dévoilement
de réalités perçues d’abord
assez confusément.
On pourrait, en effet, comparer
cet ouvrage aux tableaux pointillistes de certains peintres
néo-impressionnistes. Chaque touche frappe par
sa netteté: «C’était l’été.
Devant la maison retirée dans la fraîcheur
de ses volets clos, le jardin vacillait un peu sous
une légère houle d’ombres et de lumière,
dans le balancement du soleil émietté
par les branches». Mais les traits se succèdent,
se multiplient, se rejoignent, se chevauchent et se
juxtaposent de telle manière qu’on ne parvient
à saisir clairement la cohérence qu’après
avoir pris à leur égard un recul suffisant
(…).
Samuel Dubuis
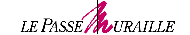

Qui est Aimée ? Quel rapport
ce personnage diffus entretient-il avec l’auteure
? Ou plutôt, Aimée est-elle une part secrète
de Sylviane Chatelain ? Question oiseuse … chaque
intervenant d’un roman devenant tour à tour
fragment de l’écrivain, l’une des mille
facettes de sa personnalité, parfois la plus
obscure, celle qu’il ne peut ou ne veut pas voir
en pleine lumière, et qui surgit, impromptue,
à travers le tamis des mots. Dans le dernier
livre de la Jurassienne, une mystérieuse Aimée
apparaît aussi éthérée qu’une
ombre irréelle. Prenant néanmoins toute
la place du livre – celle que veut bien lui laisser
Sylviane Chatelain – elle déambule dans
les pages en contrepoint de sa génitrice de plume.
Pourtant, l’auteure s’applique à détailler
ses jours dans un petit village où elle vient
d’arriver en car, jetant un coup d’œil
indifférent à celle qui la raconte. Normal
: elle n’est après tout qu’une héroïne
de papier. Du moins est-ce ainsi que Chatelain la présente,
cette Aimée, miroir déformé d’elle-même,
secret à peine suggéré. Suspendu
dans un rêve nébuleux, ce récit
se moque de la logique tout en respectant une chronologie
personnelle, la vie de la petite fille à la robe
bleue, Aimée la mal-aimée, celle qui est
de trop et qui essuie les reproches d’une mère
froide, acerbe, elle-même abandonnée, qui
confiera la petite aux bonnes sœurs. Livrée
à la solitude, réfugiée dans les
livres, Aimée affronte tous les désenchantements.
Maternel d’abord, amoureux ensuite. Il y a la mort
également, et le cruel manque de bouquins, justement.
Autant d’ingrédients qui tissent l’atmosphère
de ce récit construit à coups de détails,
d’observations de la vie quotidienne, avec ses
odeurs, ses couleurs, ses silences. Le texte est soutenu
par une écriture à fleur de peau, d’une
finesse si délicate qu’elle paraît
prête à se fissurer, brisée par sa
propre fragilité. Curieusement, une sécheresse
descriptive rappelle par moments le nouveau roman, et
ça n’est pas là le moindre des charmes
de ce livre envoûtant et si mélancolique
qu’il faut éviter de s’y plonger un
jour de pluie, quand les sapins virent au triste noir
de la nuit qui tombe.
Bernadette Richard


Le regard porté par la
narratrice sur une étrangère venue se
réfugier dans un village de montagne, à
travers les dessins du Livre d’Aimée acheté
naguère, n’est peut-être que le propre
regard de la narratrice sur elle-même. Souvenirs
d’une traversée existentielle, du bleu de
la robe de l’enfance à la prise de conscience
d’être non désirée, de l’apprentissage
de la lecture au manque cruel de livres, du désenchantement
amoureux à la rupture, tout est suggéré
dans cette introspection. C’est un texte à
l’écriture simple, évidente, d’une
densité poétique rare, le meilleur roman
lu dans la rentrée littéraire de cet automne.
Maurice Rebetez


À partir des « innombrables
visages en attente dans sa mémoire », Sylviane
Chatelain construit un superbe roman, ou plutôt
un poème en prose, rythmé par la présence
lumineuse d’Aimée, une petite fille à
la robe bleue, réminiscence du monde merveilleux,
curieux et réceptif de l’enfance…
S. Viret
Journal de Sainte-Croix
Oeuvres de Sylviane
Chatelain
Les
Routes blanches, Nouvelles, Lausanne: Editions
de L’Aire, 1986
La
Part d’Ombre, Roman, Yvonand: Bernard Campiche
Editeur, 1988
Prix Hermann-Ganz 1989 de
la Société suisse des écrivaines
et écrivains
Prix 1989 de la Commission de littérature française
du Canton de Berne
Traduction
Schattenteil,
Traduit par Barbara Traber, Berne: Editions Hans Erpf,
1991
Publié en feuilleton
dans la Neue Zürcher Zeitung
De
l’Autre Côté, Nouvelles, Yvonand:
Bernard Campiche Editeur, 1990
Prix Schiller 1991
Le
Manuscrit, Roman, Yvonand: Bernard Campiche Editeur,
1993
Traduction: Das Manuskript,
Traduit par Yla M. von Dach, Berne: eFeF Verlag, 1998
L’Etrangère,
Nouvelles, Orbe: Bernard Campiche Editeur, 1999
|
|
|
| Elisabeth
Horem / Le Chant du bosco |

ISBN 2-88241-122-7
|
|
Un pays, peu importe lequel,
une dictature, peu importe laquelle, et trois hommes
emprisonnés arbitrairement. Aucun repère
géographique ou historique précis n’est
donné. Une variété de situations,
d’images, de rêves, de fantômes, de
souvenirs, d’assemblages de fragments, confèrent
à ce roman un climat envoûtant. Un jeu
constant entre l’imaginaire et la réalité,
voire la cruauté, intrigue puis saisit le lecteur.
Restera aussi la figure bouleversante de Mona, prête
à tout pour sauver son amant.
Notice biographique
Elisabeth
Horem a fait ses études à Paris.
Elle a séjourné dans plusieurs pays du
Proche-Orient, ainsi qu’à Moscou, Berne
et Prague. Elle vit maintenant à Paris. Elle
a publié Le Ring
(1994, Prix Georges-Nicole 1994, le Prix de la Commission
de littérature du Canton de Berne 1994 et le
Prix Michel-Dentan 1995), Congo-Océan (1996)
et Le Fil espagnol
(1998), trois ouvrages dont les critiques ont souligné
la remarquable qualité d’écriture
et l’atmosphère d’étrangeté
et de mystère qui s’en dégage.
Elisabeth Horem, Le Chant du bosco,
Editions Bernard Campiche, 2002.
|
|
| Extrait
«Sans doute y a-t-il eu
plusieurs scènes de ce genre: deux hommes (parfois
un seul) faisant le guet aux abords de son hôtel,
attendant qu’il s’absente puis, le moment
venu, poussant la porte, et le réceptionniste
déjà là, surgi comme un mauvais
génie près du palmier en plastique, rayonnant
de zèle et de sueur en rendant compte à
voix basse des allées et venues de Peter Vaart,
ajoutant d’une voix implorante Si ces messieurs
désirent voir la chambre… Des doutes avaient
commencé à naître. De si petites
choses au début, cela ne valait pas la peine
d’y prêter attention: la fenêtre qu’il
avait cru fermer tout à fait, mais il pouvait
se tromper, le courant d’air qui passe sous la
porte l’aura rouverte; le rideau de plastique tiré
à moitié devant le cabinet de toilette,
qu’est-ce que cela prouve, la femme de chambre,
peut-être… Un jour, la radio marchant en
sourdine, il ne l’aurait pas laissée ainsi.
Puis de plus en plus souvent des papiers dérangés
dans son tiroir. Un mégot écrasé
dans le verre à dents. Le doute n’était
plus possible. Vaart quittait moins longtemps son hôtel,
rentrait à des heures différentes, parfois
juste après être sorti. Le réceptionniste
ne lui souhaitait plus une bonne journée. Il
ne se donnait plus la peine de se courber en deux. Il
se contentait de l’accompagner de son sourire fielleux.
S’installer dans un autre hôtel n’aurait
rien changé à l’affaire, c’était
partir qu’il fallait, bon Dieu qu’attendait-il?»
Extrait de : Le Chant du bosco
La Presse
La tyrannie du souvenir
La mémoire est une chapardeuse,
une habile plagiaire. Pour combler ses trous et fournir
les pièces manquantes d’une histoire donnée,
elle emprunte à d’autres mémoires
(collectives ou individuelles). Elle est sans cesse
travaillée par la pensée, qui procède
par ajout, substitution, récupération,
usure, répétition, et remodèle
ainsi le passé.
Se souvenir paraît vital
pour l’homme et néanmoins, certaines réminiscences
le tyrannisent tant qu’il les dissimule ou les
travestit. Au «Je me souviens» de Georges
Perec - qui a tissé la toile de son œuvre
avec les fils de la mémoire autour d’un
souvenir d’enfance capital avec les fils de la
mémoire - font écho les phrases d’Elisabeth
Horem. «Ne rien omettre. Recommencer sans se décourager.»
«Nommer chaque chose pour se défendre pied
à pied contre l’oubli». «Refaire
sans arrêt l’inventaire de la ville.»
«Puis refaire le chemin en sens inverse, ne pas
se lasser. Ne rien oublier surtout».
A Obronna, la répression
a succédé à une tentative d’insurrection
contre la dictature. Après avoir été
arrêté et incarcéré deux
fois lors des troubles, Vaart fuit cette ville. En prison
comme en exil, il cartographie la cité avec un
souci obsessionnel de rigueur et pourtant il n’en
mentionne pas le cœur tragique, la forteresse.
Omission soulignée par le narrateur qui fait
de ce lieu occulté le théâtre du
Chant du bosco, y redistribue les cartes et laisse s’y
jouer les destins du héros, Vaart, et de son
double tragique.
Si les correspondances entre
ces deux personnages forment ici un réseau où
les énigmes se dénouent avec une évidence
qui crée un saisissant contraste avec la complexité
de l’architecture littéraire, elles relient
également ce récit aux trois autres titres
d’Elisabeth Horem qui reprend, retouche, considère
sous un angle différent des éléments
- exilé vivotant de traductions, héros
venu d’Obronna attelé à sa biographie,
pays sous haute tension politique, vie soumise à
la fatalité, voire à l’absurde, photographies
- d’un univers romanesque qu’elle est en train
de bâtir. Son écriture en escalier progresse
de relatives en comparaisons suggérées,
d’associations en images pleinement évocatrices,
et accomplit la prouesse de conserver sa sérénité
dans les houles qu’elle traverse. Que subissent
en l’occurrence deux individus confrontés
à l’arbitraire d’un régime autoritaire,
à l’enfermement et à la suspicion,
et dont les trajectoires un jour se rencontrent et s’échangent
dans le miroir du temps, au milieu d’une comédie
où trône la belle Mona au visage à
deux faces ainsi que le despote, tantôt entouré
d’une cour grotesque de vieillards agitant des
fleurs en papier, tantôt brillant par son absence
menaçante.
L’imagination ronge patiemment
l’os du souvenir
Le passé se juxtapose
au présent, la mémoire délivre
des fragments que la narration assemble en sillonnant
non pas le cauchemar d’une nation - «tout
cela a déjà été raconté
ailleurs» -, mais celui d’un individu que
la privation de liberté a jeté sur les
routes. Après avoir cogné son esprit aux
barreaux des hommes, été captif d’un
mauvais rêve éveillé, d’un
amour volé et du silence, Vaart s’embarque
pour l’ailleurs, où jamais il ne s’établit.
Il est sans attaches, voué à l’éternelle
errance. L’atmosphère du camp, les rumeurs
de la forteresse, le plan d’Obronna, les traits
de Mona, la mise à mort du frère maudit,
le père honni, l’adieu au pays, «tout
est à réinventer»: à partir
de lueurs (feux, ampoule, phare, souvenir, espoir) ou
de lumières (soleil, départ en exil) qui
se détachent du roman et renforcent l’obscurité
de son climat d’oppression et de conflit larvé.
A partir d’un détail dont l’imagination
s’empare «comme une chienne affamée»
d’un «os qu’elle va ronger un moment».
Passent les vies et les souvenirs,
restent les fictions, les chants de boscos qui résistent
aux lames de fond, guidés par la précision
de leur écriture, poussés par leur souffle
créateur.
Elisabeth Vust
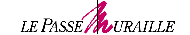

Troublant, Le
Chant du bosco, d’Élisabeth Horem,
sort des sentiers battus et confirme un écrivain
singulier.
Dans son quatrième roman,
Élisabeth Horem choisit ses métaphores
avec goût. Sa prose souple et précise installe
d’emblée une ambiance aussi envoûtante
que troublante qui gardera jusqu’à la fin
sa part de mystère. On ne sait pas dans quel
pays l’on se trouve, qu’importe d’ailleurs,
juste que la ville dont il est ici question se nomme
Obronna et qu’un été, celui de l’attentat,
elle fut «figée sous l’œil fixe
d’un soleil immobile », imposant alors que
l’on garde continuellement les volets fermés.
… Élisabeth Horem
remplit progressivement certains blancs de l’histoire,
plaçant çà et là une nouvelle
pièce du puzzle, mais pas toutes. Tout au long
de ce mince Chant du bosco, elle promène ainsi
son lecteur à travers un univers obsessionnel,
le temps d’une belle réflexion sur l’enfermement,
la fuite sans fin.
Alexandre Fillon
LivresHebdo

… Dans ce nouveau livre
aussi, tout part de presque rien : un train qui file
dans la nuit, trois silhouettes d’hommes aperçues
par la fenêtre. Aussitôt l’imagination
(ou la mémoire) de Peter Vaart « s’est
mise en chasse, bête affamée rôdant
sans cesse à la recherche d’un os à
ronger ».
L’écriture nette
d’Élisabeth Horem emprunte au vocabulaire
marin ses mots précis et poétiques (le
bosco désigne à bord le maître de
manœuvre, donc une sorte de frère de l’écrivain).
Sans donner nul repère qui permette de situer
les lieux et les faits autrement qu’en sollicitant
l’imagination de ses lecteurs, elle tient la gageure
de dénoncer toutes les dictatures, à sa
façon, c’est-à-dire en suggérant
le pire sans jamais hausser le ton. Cela grâce
à la texture subtile d’un récit qui
naît sous nos yeux, parce que « tout reste
à inventer ».
Isabelle Martin
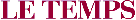
Oeuvres d'Elisabeth Horem
Le
Ring, Roman, Yvonand: Bernard Campiche Editeur,
1994
Prix Georges-Nicole 1994
Prix de la Commission de littérature française
du Canton de Berne 1994
Prix Michel-Dentan 1995
Traduction allemande
Der Ring, Collection
CH, Traduction de Markus Hediger, Basel: Lenos Verlag,
1996
Congo-Océan,
Roman, Yvonand: Bernard Campiche Editeur, 1996
Prix d’encouragement de
la Ville de Berne
Le
Fil espagnol, Roman, Orbe: Bernard Campiche Editeur,
1998
|
Page créée le 02.12.02
Dernière mise à jour le 02.12.02

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|