|
Scènes Magazine - Feuilleton littéraire
Urs Widmer - David Lodge - Entretien avec
Jean-Michel Olivier
| L'Homme que ma mère
a aimé, Urs Widmer, Gallimard, 2001 |
|
La vie secrète
Né en 1938, à Bâle,
Urs Widmer est l'auteur d'une dizaine de romans et de récits,
la plupart publiés en Allemagne (on en trouve des traductions
chez Fayard et à L'Age d'Homme). Chez nous, il est
connu grâce au succès de sa pièce de théâtre,
Top Dogs, montée
il y a quelques années par la compagnie Gardaz-Michel.
Pièce qui, on s'en souvient, mettait en scène
une poignée de cadres supérieurs au chômage,
et leur faisait passer un entretien d'embauche à la
fois drolatique et émouvant.
On retrouve cet esprit cocasse et poignant
dans le dernier roman de l'écrivain alémanique,
L'Homme que ma mère a aimé*. Widmer entreprend
d'écrire ici la vie de sa mère, sous une forme
romancée, mais, semble-t-il, très proche de
la réalité. Ce portrait étonnant de Clara,
en même temps qu'une confession bouleversante de l'auteur,
est aussi une tentative de réhabilitation de sa mère.
Hommage posthume de celui qui a su dompter les mots à
la femme qui fut éternellement dans l'ombre et le silence.
L'ombre de Paul Sacher
Tout commence par un curieux tour du
destin : Clara, issue d'une riche famille de négociants
du Piémont, rencontre un jour Edwin, fou de musique
contemporaine et sans le sou (derrière Edwin on peut
reconnaître Paul Sacher, le grand mécène
et chef d'orchestre bâlois). Elle l'aide à monter
son orchestre, joue à la fois les secrétaires,
les managers et les nounous, porte littéralement à
bout de bras l'orchestre de jeunes musiciens qui donne ses
premiers concerts à Bâle dans les années
30. Suivant Edwin comme son ombre, Clara devient sa maîtresse,
croyant par là avoir dans la vie du grand homme une
place sinon officielle, du moins privilégiée.
Elle va même tomber enceinte du chef d'orchestre, qui
l'aidera (dans la version qu'elle donnera à son fils)
à avorter. C'est par le plus grand des hasards que
Clara apprendra, un jour, qu'Edwin vient d'épouser
la fille d'un riche industriel bâlois. Elle n'en continuera
pas moins à se dévouer pour la cause de l'Orchestre
et de son chef, comme si sa vie, toujours, dépendait
de cet homme froid et distant, qu'elle ne cesse d'aimer jusqu'à
sa mort, et qui ne l'aimait pas. Clara se mariera à
son tour, aura un enfant (le narrateur), sombrera dans la
dépression, au point de passer de longs mois en clinique,
puis elle vivra dans un asile. Jusqu'au moment où elle
choisira d'en finir, seul geste de liberté véritable
de sa vie, en sautant par la fenêtre de sa chambre.
Dans ce livre magnifiquement traduit
par Bernard Lortholary (quel sens du rythme et du mot juste
!), Urs Widmer écrit plus qu'un roman. Il joue sa vie
à faire revivre cette femme silencieuse, incurable
en amour, qui traverse la vie comme une somnambule. Lourd
de secrets et de mélancolie, ce roman a le poids des
livres essentiels, ceux qui changent à la fois la vie
de l'écrivain et celle du lecteur.
|
|
| Pensées
secrètes, David Lodge, Rivages, 2002 |
|
Pensées secrètes
Avec David Lodge, né à
Londres en 1935, on change de registre, mais pas nécessairement
de sujet, même si son dernier roman, Pensées
secrètes**, avec son humour ravageur, semble
à des lieues du livre intimiste de Widmer.
Nous sommes une fois de plus sur le
campus de Gloucester, cette Université imaginaire que
Lodge a construite de livre en livre, et qui semble plus vraie
qu'Oxford ou Cambridge. Ralph Messenger, un professeur de
sciences cognitives, spécialiste en intelligence artificielle
et grand coureur de jupons, rencontre Helen Reed, une romancière
qui vient de perdre son mari. Pris l'un et l'autre au jeu
de la séduction, ils vont tenter de s'approcher, ils
vont chercher à pénétrer dans les secrets
de l'autre. Pour figurer cette parade amoureuse, Lodge utilise
un stratagème ingénieux qui permet au lecteur
d'entrer dans le “ cerveau du monstre ” : tandis
que Messenger dicte à un logiciel de reconnaissance
vocale tout ce qui lui passe par la tête (pour cerner
au plus près les phénomènes de conscience),
l'écrivaine tiendra scrupuleusement son journal, écrivant
elle aussi au plus près de sa conscience (on ne ment
pas à son journal). Le roman avance donc sur ce tempo
binaire qui permet de multiples clins d'œil, des rapprochements
inattendus et toutes sortes d'anticipations (car le lecteur
connaît les désirs de chacun des personnages
pour l'autre).
Éros et thanatos
Bien sûr, le ton de ces “
journaux croisés ” est totalement différent
: alors que le courant de conscience de Messenger est irrésistiblement
attiré par le sexe, sous toutes ses formes et avec
le plus de partenaires possibles, le journal d'Helen Reed
se veut plus réfléchi, plus maîtrisé,
plus proche aussi de cette âme à laquelle elle
croit. Reprenant le vieux débat platonicien de l'âme
et du corps, Lodge en livre une version postmoderne (et hilarante)
en mettant face à face deux personnages aux conceptions
opposées : Messenger tenant pour les sciences exactes,
parfaitement matérialiste et athée, mais sans
être cynique, et Helen Reed prisonnière encore
des schémas religieux.
Traduit de fort belle manière
par Suzanne V. Mayoux, Pensées secrètes est
une grande réussite (malgré son côté
didactique et ses longueurs). Peut-être même le
roman le plus original de David Lodge, qui n'en est plus à
son coup d'essai. En un mot : un régal !
Jean-Michel Olivier
* L'Homme que ma mère a aimé,
roman, par Urs Widmer, Gallimard, 2001.
** Pensées secrètes, roman, par David Lodge,
Rivages, 200
Retrouvez les pages du feuilleton littéraire
sur le site culturactif.ch avec toute l'actualité culturelle
de Suisse, ainsi que sur le site www.jmolivier.ch.
|
Cet article de Jean-Michel Olivier
a été reproduit avec l'autorisation de
la revue SCENES-MAGAZINE
case postale 129 - CH 1211 Genève 4 tél.
022.346 96 43
|
|
|
| Entretien avec
Jean-Michel Olivier par Elena Vico |
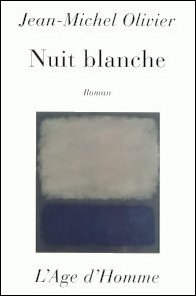 |
|
Son dernier roman, Nuit blanche, paru en l’an
2001, parsemé d’ironie et de réflexions
existentielles, trace un tableau du XXIe siècle
genevois à travers dix noctambules d’une
nuit blanche pas comme les autres, puisqu’au
seuil du millénaire. La présence
du désir court dans toutes les lignes de
ce roman. La place accordée à l’image
(photographie et Internet) et à la musique
(le pianiste et Anne, la fan de techno) berce
le lecteur d’une rive à l’autre
- Comment vous est venue
l’idée d’écrire un roman
sur des personnages qui se croisent et ne se rencontrent
pas, malgré leurs liens humains ?
- J'ai multiplié
entre eux les signes de connivence, les liens
secrets, les points communs (il y a un père
et sa fille, le petit ami de cette fille et son
ex à lui, une mère et son fils musicien,
etc.). J'ai travaillé sur l'idée
de couple au sens large. Et, d'un autre côté,
ces personnages qui auraient tant à partager
ne se voient pas, ne se reconnaissent pas. C'est
une allégorie du siècle : plus il
y a de moyens de communication, moins l'on se
parle, moins l'on s'entend. C'est pourquoi, sans
doute, le lien social n'a jamais été
aussi fragile qu'aujourd'hui
|
|
- Nuit blanche évoque un désir
humain quasi omniprésent à travers les thèmes
tabous de la sexualité et de la transexualité,
tout en traitant l’agonie humaine. Pourquoi avoir choisi
cette ambiance décadente?
- Toutes les fins de siècle
se ressemblent ! On imagine toujours que quelque chose se
termine, et qu'autre chose commence. Mais personne, bien sûr,
ne sait quoi d'où l'importance de l'agonie, comme vous
l'avez remarqué, qui est une mort douce, une fin qui
ne vient pas. On dirait que les fins de siècle concentrent
toute la fatigue humaine, toutes les déceptions, toutes
les désillusions d'une époque. J'ai voulu parler
de ça et en même temps imaginer une autre voie,
qui ne serait pas celle de la guérison ou du salut
spirituel, mais d'une sorte d'apaisement.
- Les sombres aspects du sida, de la
toxicomanie, de la violence citadine sont incarnés
par quelques personnages contrastés par d’autres
figures aimant la musique, la danse et l’image. Est-ce
dû au lien sous-jacent de la marginalité entre
ces personnages fictifs?
- J'aime les personnages singuliers.
Qui ne sont prisonniers d'aucune structure, ou qui essaient
de s'en libérer, parce qu'ils s'y sentent mal. J'aime
aussi les contrastes entre des personnages plutôt conventionnels
(comme Géraldine, la mère du pianiste, qui fait
très beaux quartiers genevois) et, par exemple, Joker,
le skinhead, ou Ellie, la transexuelle. Affectivement, quel
que soit leur milieu social, ils se retrouvent tous dans une
même marginalité. Parce qu'aujourd'hui, comme
le dirait mon ami Frochaux, l'homme se définit d'abord
par sa solitude.
- La Nuit de la ville de Genève
est un décor de théâtre pour vos dix protagonistes
ou plutôt un protagoniste en soi ?
- Cette nuit-là (celle du 31
décembre 1999 au 1er janvier 2000) était proprement
théâtrale, puisqu'il y avait des spectacles aux
quatre coins de la ville, symbolisés par un élément
(eau, terre, feu, air). Et le spectacle était partout,
sur les scènes et dans la rue. C'était un foisonnement
de musiques et de rythmes, de masques, de lumières,
d'embrassades. Toute la ville était rassemblée
pour un soir au même endroit, comme une immense Landsgemeinde
! J'ajouterai que Genève joue un rôle essentiel
dans mes livres, non seulement comme cadre (j'aime que les
livres se passent quelque part), mais comme un personnage
à part entière avec son histoire et ses figures
mythiques (Calvin, Rousseau, Haldas, Michel Simon, Albert
Cohen, etc.), son ambiance, ses lieux secrets et magiques
: la pointe de la Jonction, par exemple, où le Rhône
et l'Arve se marient…
- Comment s’agencent les séquences
des dix personnages entre elles ?
- La règle fondamentale, c'est
la stricte alternance des voix masculine/féminine.
Le roman s'ouvre sur un duo (comme à l'opéra)
qui se fissure bien vite, puis c'est Cora qui parle, puis
l'ethnologue (un homme), puis Ellie (une femme), puis le Fou
de l'Internet (un homme), etc. C'est par cette alternance,
cette double voix, que le roman progresse.
Elena Vico
Jean-Michel Olivier, Nuit blanche, roman,
L'Age d'Homme, 2001.
Retrouvez les pages du feuilleton littéraire sur le site culturactif.ch avec toute l'actualité culturelle de Suisse, ainsi que sur le site www.jmolivier.ch.
Page créée le 08.05.02
Dernière mise à jour le 08.05.02

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|